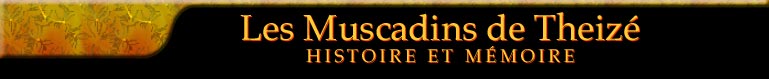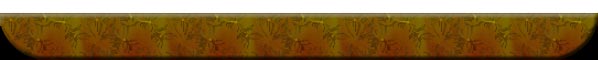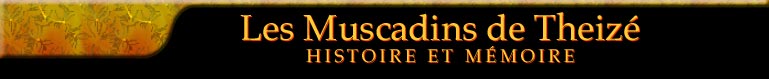Au pays
des pierres dorées (bis)
En
1793, la région de Theizé (grosso modo les
cantons d’Anse et du Bois d’Oingt) est rattachée
depuis seulement trois ans au district de Villefranche et
donc au Beaujolais. Avant cette date, Theizé et la
plupart des communes qui bordent les bois d’Alix, faisaient
partie intégrante de la Sénéchaussée
de Lyon.
À
propos de de la vie des Theizerots à la veille de
la Révolution, le rédacteur de Theizé
en Beaujolais qui a travaillé d’après
les registres paroissiaux, nous précise que la population
d’alors était sensiblement égale à
celle d’aujourd’hui (à peu près
1000 habitants) et que le taux de mortalité infantile
était alourdi par les enfants lyonnais mis en nourrice
dans la commune. Les eaux du Merloux animaient trois moulins,
à
la Calle, à Bourland
et à Beauvallon ; un moulin à huile fonctionnait
aussi à Grands Fonds. À
Beau-vallon encore, un four à chaux ; et des carrières
un peu partout.
La
vigne était déjà présente, mais
elle ne devait recouvrir guère plus de 20%43 des
parcelles dans cette région trop éloignée
de Lyon et à l’écart des grandes voies
de communication. Ce qui n’empêchait pas toute
commercialisation puisqu’on retrouve du vin de Theizé
dans les comptes de l’exercice 1761-1764 de la Grande
Taverne de la Charité à Lyon1.
On
possède par ailleurs une assez bonne description
de la commune pour 1697 grâce à l’enquête
de l’intendant Lambert d’Herbigny2.
On y apprend que le territoire de la paroisse s’étendait
alors sur «deux lieues» dont le tiers était
constitué de montagne et de lieux incultes, le sixième
de vigne, le douzième en prairie et un autre sixième
en bonne terre «assez forte» sur laquelle on
pratiquait la culture du blé et du seigle en assolement
biennal. Sur ce territoire vivaient 117 hommes mariés,
39 célibataires de plus de vingt ans et 143 garçons
de moins de vingt ans. Également 143 femmes mariées
ou veuves, 18 filles de plus de vingt ans et 137 filles
de moins de vingt ans. Soit une population de 597 habitants
qui avait subi une diminution d’environ un quart dans
les trois ou quatre dernières années à
cause de la pauvreté, de la disette et des maladies.
Ce chiffre, très important en lui même, montre
néanmoins que les Theizerots étaient relativement
privilégiés par rapport à leurs voisins
immédiats puisque les chiffres dont nous disposons
pour Frontenas et Chessy montrent que dans ces communes
cette diminution était d’environ 50%.
Mais
l’enquête de 1697, présente une «photographie»
de la commune à un des pires moments de l’ancien
régime puisqu’elle a été effectuée
seulement quatre ans après la dernière grande
famine de l’époque moderne, celle de 1693-94.
La vie des habitants du village et des communes environnantes
a indéniablement
connu une amélioration au cours du XVIIIe siècle
qui, bien qu’il n’ait été marqué
par aucun progrès spectaculaire en matière
agricole, a néanmoins et globalement été
un siècle de croissance. On peut d’ailleurs
s’en faire une idée en comparant la population
de Theizé en 1697 (597 h) à l’estimation
que nous en donne l’abbé Berthaud à la
veille de la révolution (1000 h).
Une
enquête similaire à celle de Lambert d’Herbigny,
a été dilligentée par l’Abbé
de Cordon en 17883.
Les renseignements qu’on y trouve doivent être
manipulés avec prudence : d’abord ils ne concernent
pas Theizé dont les réponses sont perdues,
ensuite il s’agit d’une enquête fiscale
et les villageois qui y ont répondu ne se sont certainement
pas souciés d’y exagérer leur prospérité.
Ces réserves étant faites, on peu tout de
même tirer parti des Instructions… de l’Abbé
de Cordon pour se faire une idée de la réalité
de la vie dans les parages qui nous intéressent à
la veille de la Révolution.
On
apprend donc qu’à Oingt, «les habitants
étant pauvres sont obligés, dans le temps
des moissons, d’aller travailler en Bresse et Dombes
pour y gagner quelques bichets de bled dont la majeure partie
rapporte des fièvres qui les font passer et laissent
leurs veuves et leurs enfants dans la plus affreuse misère.»
Que le cheptel de la commune, qui compte trois ou quatre
cents habitants, est constitué de sept paires de
bœufs, dix huit vaches et quatre vingt moutons, mais
qu’il n’y a ni porc, ni cheval, ni âne.
Que «les productions de la commune ne consistent qu’en
vin de très petite qualité et en très
peu de bled ; on ne peut même pas [s’y] défaire
des vins, tant à cause de leur mauvaise qualité,
qu’à cause de l’éloignement des
grandes routes.» Au Breuil et à Chessy, les
réponses sont un peu moins spectaculaires mais similaires.
La situation des habitants de Theizé devait être
certainement un peu meilleure que celle des paroissiens
d’Oingt, de Chessy ou du Breuil. Nous avons vu que
déjà, en 1693-94, à Theizé on
avait relativement moins souffert de la famine. D’autres
indices (le nombre de moulins bien supérieur à
Theizé qu’à Chessy ou qu’à
Oingt, le fait que Theizé commercialisait une partie
de sa production vinicole…) nous permettent de dire
que les Theizerots d’alors étaient très
probablement des privilégiés par rapport à
leurs voisins.
Il
n’en demeure pas moins qu’ils vivaient dans une
région excessivement pauvre, voire misérable
et que ce privilège devait être bien mince.
Sur leurs maigres revenus, les Theizerots et leurs voisins
devaient bien entendu prélever la part du fisc ;
et là les petits et moyens propriétaires des
campagnes trouvaient un sujet de se plaindre non seulement
du percepteur mais également de leurs voisins de
Lyon. En effet, les bourgeois de Lyon (il suffisait d’être
propriétaire dans la ville pour jouir de ce titre)
étaient alors exemptés de la taille et ceci
concernait non seulement leurs maisons de ville mais également
leurs propriétés champêtres. Le montant
de la taille était fixé pour chaque paroisse
en fonction du revenu théorique de toutes les propriétés
(y compris celles des Lyonnais) ensuite, ce montant global
était réparti sur tous les propriétaires
non privilégiés de la commune. … Il est
possible que cet état de chose ait entraîné
une certaine animosité envers les ressortissants
de la grande ville. 
1 - D'après
l'enquête de l'intendant Lambert d'Erbigny de 1697
— Archives Départementales du Rhône
:1C 4.
2 - D'après Durand
(G.) Vin Vigne et Vigneron en Lyonnais et Beaujolais
(XVIe-XVIIIe siècles), p. 92.
3 - A.D.R. 9C 61 Instructions
demandées par le Département de l'Élection
de Lyon aux municipalités. M. l'Abbé Cordon
aîné, comte de Lyon, Président du Département.