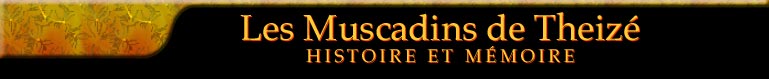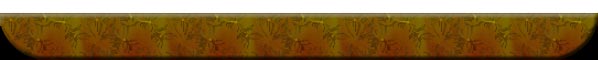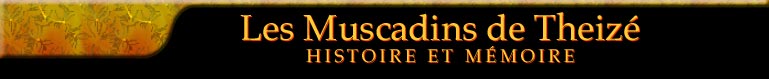Préface
Préface Par Françoise BAYARD
Historienne1,
Ancien Doyen de la Faculté d'Histoire de Lyon.
Quel
Lyonnais ne connaît pas Theizé, «ce petit
paradis Toscan lumineux comme la pierre
dont il est issu», situé à une vingtaine
de kilomètres de la capitale des Gaules, dans le «pays
des pierres dorées» ? Quel visiteur manquerait
d’y évoquer le souvenir paisible de Manon Phlipon,
de son époux Jean-Marie Roland de la Platière
et de leur
fille Eudora qui séjournèrent
au clos de la Platière de 1784 à 1788 ? Comment
pourrait-il raisonnablement penser que ces lieux paisibles ont
été le théâtre de meurtres —
que nous nommerions aujourd’hui crimes contre l’humanité
— il y a plus de deux cents ans ?
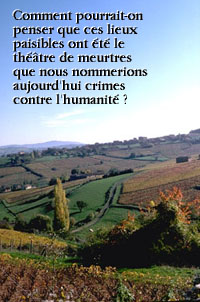 Mai
1793 : les élections municipales donnent à la
ville de Lyon un maire girondin. Le mois
suivant, le gouvernement de la Nation devient montagnard. Durant
l’été, la situation du pays est désespérée.
Aux frontières c’est l’invasion. A l’intérieur,
l’insurrection s’étend sur une grande partie
du territoire : soixante départements se sont insurgés
contre la proscription des Girondins ; les départements
de l’ouest contre la politique religieuse et la levée
des 300000 hommes ; ceux du midi contre l’exécution
du souverain au début de l’année. Progressivement,
le gouvernement révolutionnaire, codifié par la
Convention le 4 décembre 1793, se met en place. Dans
un tel climat, après l’échec de pourparlers,
l’assemblée décide de faire le siège
de la ville. Plus de 50000 hommes l’encerclent.
Mai
1793 : les élections municipales donnent à la
ville de Lyon un maire girondin. Le mois
suivant, le gouvernement de la Nation devient montagnard. Durant
l’été, la situation du pays est désespérée.
Aux frontières c’est l’invasion. A l’intérieur,
l’insurrection s’étend sur une grande partie
du territoire : soixante départements se sont insurgés
contre la proscription des Girondins ; les départements
de l’ouest contre la politique religieuse et la levée
des 300000 hommes ; ceux du midi contre l’exécution
du souverain au début de l’année. Progressivement,
le gouvernement révolutionnaire, codifié par la
Convention le 4 décembre 1793, se met en place. Dans
un tel climat, après l’échec de pourparlers,
l’assemblée décide de faire le siège
de la ville. Plus de 50000 hommes l’encerclent.
La
cité résiste quasi seule. Quelques troupes et
des armes viennent du Forez. Le Beaujolais
ne bouge pas. Depuis longtemps, ses relations avec la capitale
des
Gaules ne sont pas bonnes. En mars 1789, nombre de cahiers de
doléances beaujolais s’élèvent contre
la grande ville qui ponctionne, depuis des siècles, les
biens
et les enfants de la région et réclament d’en
être séparés. Les débuts de la Révolution
ne leur donnent pas gain de cause. Les nouveaux événements
peuvent y aider. L’hostilité latente se double d’opposition
politique. La Montagne n’est pas ici mal perçue.
Après
deux mois de résistance, les troupes qui ont défendu
Lyon (6 à 7000 hommes) estiment la défense impossible.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre, sous la conduite
de leur général, le Comte de Précy, elles
sortent et se dirigent vers le nord. Que sont-elles devenues
? C’est à une véritable enquête que
se livre Jacques Branciard
dans son ouvrage sur les Muscadins de Theizé .
Au
centre de sa recherche, une seule et unique question : les troupes
du général Précy ont-elles été
dépouillées et massacrées, en octobre 1793,
par certains habitants du village de Theizé, enrichis
depuis et qualifiés de Muscadins, surnom qu’on donnait
alors à ceux qui n’étaient pas favorables
aux Jacobins ? L’intérêt peut sembler mince
pour ceux qui ne demeurent pas dans la région. Mais la
méthode utilisée par Jacques Branciard, qui s’inscrit
dans le champ historique assez peu exploré de la mémoire
des faits à travers les siècles, dépasse
le cadre local. Il rejoint d’illustres prédécesseurs,
particulièrement Philippe Joutard qui l’expérimenta
sur les Camisards des Cévennes et Anne-Marie Granet-Abisset
sur les migrants du Queyras.
Quatre
étapes caractérisent sa démarche. Partant
de la rumeur qui circule encore de nos jours dans la région,
il essaie de recueillir des informations orales auprès
des personnes ayant travaillé sur la question («la
mémoire des érudits»). Il part ensuite «sur
le terrain» pour rencontrer et écouter les habitants
du village. Après avoir inventorié cette «mémoire
des faits», peu précise, voire absente — Jacques
Branciard parle même de «conspiration du silence»—,
il s’interroge sur les «relais de la mémoire»
— tous les écrits de diverse nature qui l’ont
aidée à se mettre en place. Enfin il va aux sources
: récits et, surtout, archives révolutionnaires.
Sont ainsi sollicités les mémoires du général
Précy, de son aide de camp, Edme de la Chapelle de Béarnès,
de l’artilleur Monte-au-ciel qui dicta son témoignage
à son neveu Dussieux et du diacre Terraillon, la commission
des inhumations, les rapports du général Doppet,
le procès de Théodore Chabert, les délibérations
du conseil municipal de Quincieux et le mémoire pour
le citoyen Antoine Danguin.
Jacques
Branciard va pas à pas et livre peu à peu ses
conclusions. L’événement que les «vrais
Theizerots» ne veulent pas dire, que les monographies
régionales minimisent et que les études, en particulier
celle d’Eugène Berlot-Francdouaire (1909), localisent
mal, se met alors en place de manière précise,
claire et définitive.
Au
difficile sortir de Lyon, les troupes de Précy se sont
séparées en deux. Sous la direction du général,
le premier groupe est bien parvenu dans le secteur de Theizé
les 10 et 11 octobre et a été attaqué par
les habitants. Le deuxième a reflué dans les bois
d’Alix le 10 octobre et y a été mis en pièces
par les troupes de la Convention et par les villageois. Antoine
Danguin, habitant de Theizé et commissaire du canton
du Bois-d’Oingt a organisé la chasse aux insurgés,
comme ses fonctions l’obligeaient à le faire. Il
a été compris, aidé et soutenu par ses
concitoyens et les habitants des villages voisins qui sont même
allés bien au-delà de ce qui leur était
demandé. Tous les biens des fuyards ont été
pris; certains ont été égorgés ou
assommés. Il a donc dû intervenir pour modérer
leur ardeur.
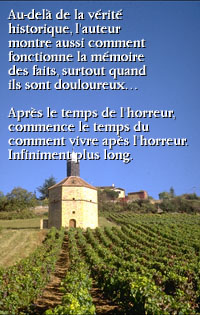 Comment
expliquer, cependant, que seul les Theizerots soient, jusqu’à
présent, qualifiés de Muscadins alors que nombre
d’habitants de la région ont participé à
la traque des fuyards ? Jacques Branciard prolonge son enquête.
Le feuilleton de Dominique Giuliani Les Mystères des
bois d’Alix paru en 109 épisodes, entre septembre
1899 et février 1901, dans le Réveil du Beaujolais,
journal nationaliste, anti- dreyfusard et anti-radical, et surtout
son accueil dans la région, lui fournissent
les éléments d’une hypothèse. Ce roman
à clé révélerait les tensions politiques
du début du XXe siècle, quand les «Muscadins»
(ou «gros») étaient à droite et les
«Non-Muscadins», à gauche et que deux familles
se disputaient la mairie du village. Sur leur pression, l’auteur
dut préciser que les massacres qu’il avait commencé
à raconter avaient été perpétrés
par des étrangers au pays et arrêter sa publication.
Comment
expliquer, cependant, que seul les Theizerots soient, jusqu’à
présent, qualifiés de Muscadins alors que nombre
d’habitants de la région ont participé à
la traque des fuyards ? Jacques Branciard prolonge son enquête.
Le feuilleton de Dominique Giuliani Les Mystères des
bois d’Alix paru en 109 épisodes, entre septembre
1899 et février 1901, dans le Réveil du Beaujolais,
journal nationaliste, anti- dreyfusard et anti-radical, et surtout
son accueil dans la région, lui fournissent
les éléments d’une hypothèse. Ce roman
à clé révélerait les tensions politiques
du début du XXe siècle, quand les «Muscadins»
(ou «gros») étaient à droite et les
«Non-Muscadins», à gauche et que deux familles
se disputaient la mairie du village. Sur leur pression, l’auteur
dut préciser que les massacres qu’il avait commencé
à raconter avaient été perpétrés
par des étrangers au pays et arrêter sa publication.
Grâce
à l'auteur, on sait maintenant que le roman n’était
pas une fiction. Au bout d’une analyse exemplaire, les
faits sont désormais définitivement établis.
Au-delà, toutefois, de la vérité historique,
Jacques Branciard montre aussi comment fonctionne la mémoire
des faits, surtout quand ils sont douloureux. C’est une
autre vérité qu’on aurait pu rencontrer dans
n’importe quel village, lors de n’importe quelle guerre,
civile ou non, dans n’importe quel pays, à n’importe
quelle époque. Après le temps de l’horreur
commence le temps du comment vivre après l’horreur,
infiniment plus long. Jacques Branciard éclaire l’un
et l’autre. Magistralement.
1 - Professeur
d'Histoire moderne à l'Université Lumière-Lyon
2, Françoise Bayard est une spécialiste du monde
de la finance à l'époque moderne. On lui doit
notamment Le Monde des Finnaciers au XVIIe siècle
(Flammarion 1988) et, en collaboration avec Pierre Guignet,
L'Économie Française aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles (Orphys 1991). Cette Lyonnaise
est également l'auteur de L'Histoire de Lyon
(Horvath 1989) de Lyon intélligence d'une Ville
(Ouest France 1995).