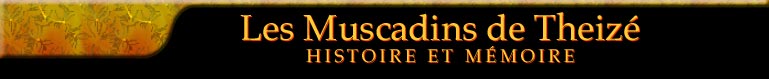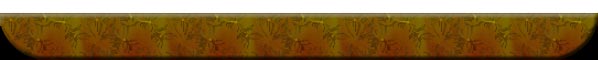Les Muscadins
Sans
refaire ici l’histoire de Lyon pendant la Révolution,
ni même faire le récit du siège de la ville
par les troupes de la Convention en 1793. Il convient cependant
de rappeler quelques faits qui vont nous permettre de comprendre
qui étaient ces soldats qui sortirent de la ville au
matin du 9 octobre 1793 et qu’on appelait les muscadins.
En
1789, la ville de Lyon n’a pas encore «passé»
le Rhône, et sa population est regroupée sur les
quais de la Saône et dans la Presqu’île. Avec
les faubourgs de Vaise, de la Croix Rousse et de la Guillotière
la cité compte environ 150 000 habitants.
L’activité
principale de la ville est le tissage et le commerce de la soie,
industrie florissante naguère mais en pleine crise. On
estime en effet qu’à la veille de la Révolution
un tiers des canuts est au chômage. Cette crise économique
engendre bien évidemment des tensions sociales ; face
aux 60000 canuts, deux à trois mille privilégiés,
nobles ou bourgeois dont une centaine de familles qui tiennent
les rênes du pouvoir politique et économique et
qui se succèdent à la tête de la municipalité
de l’époque : le Consulat constitué d’un
Prévôt et de quatre Échevins.
La tension sociale qui s’était cristallisée
notamment lors de deux crises très dures en 1744 et 1786
va être ravivée en 1789 et aboutira à de
nouvelles émeutes. Le Consulat fait alors appel à
la fois aux troupes de lignes et «aux bons citoyens»
qui constituent une garde bourgeoise de volontaires pour réprimer
les troubles.
Cette garde bourgeoise ne sera dissoute qu’en février
1790 et pendant les premiers mois de la Révolution, elle
sera l’instrument privilégié du premier échevin
Imbert Colomes, dans sa tentative de résistance à
la mise en place des nouvelles institutions démocratiques47.
C’est dans cette
milice que se trouve l’origine du sobriquet de muscadins
donné aux soldats lyonnais.
Pour
certains auteurs, le mot aurait d’emblée désigné
une certaine jeunesse dorée qui affectionnait particulièrement
le musc. L’appellation serait donc tout naturellement passée
aux miliciens du premier échevin ; et comme nombre de
ces jeunes gens servirent dans les rangs insurgés lors
du siège, l’appellation péjorative aurait
fini par englober toutes les troupes lyonnaises. Et de là,
par le relais des représentants en mission qui dirigeaient
le siège de la ville, elle serait passée dans
le lexique national et aurait fini par désigner les bandes
de jeunes agitateurs royalistes du Directoire ; acception sous
laquelle le terme est passé à la postérité.
Mais pour l’auteur lyonnais Ballaguy48 le mot aurait tout
d’abord désigné les commis du négoce
lyonnais et notamment ceux du négoce de la soie qui avaient,
entre autres attributions, celle de receptionner et de rétribuer
le travail des canuts. Tâche dans laquelle ils ne se seraient
pas rendus populaires auprès de ces derniers qui moquaient
leurs manières et leur parfum et qui les auraient baptisés
muscadins.
Lors de la formation de la milice d’Imbert Colomes, ces
Muscadins furent appelés à servir aux côtés
des fils de leurs patron. Et ce serait donc à eux que
la garde bourgeoise devrait cette appellation. Ballaguy raconte
notamment (mais malheureusement il ne cite pas ses sources)
qu’une des premières interventions de ces hommes
(après qu’ils eurent contribué à mater
l’émeute lyonnaise) fut d’aller réprimer
les troubles du Dauphiné et qu’en rentrant «victorieusement»
à Lyon, ils empruntèrent la Grande rue de la Guillotière
où ils furent accueillis aux cris de «muscadins»
et bombardés de divers objets par la population du Faubourg
massée aux fenêtres.
Plusieurs
éléments nous donnent à penser que cette
explication est la bonne. D’abord le dictionnaire des Goncourt
atteste qu’encore au XIXe siècle les commis des
magasins Lyonnais étaient désignés comme
des muscadins49 et le Larousse du XXe siècle établit
que dans les années trente, à Lyon, ce mot était
toujours appliqué aux commis des magasins de denrées
coloniales. Ensuite et surtout nous avons retrouvé dans
un texte de 1794 une définition de ce terme ; et elle
corrobore tout à fait l’hypothèse de Ballaguy.
Elle est tirée d’un mémoire intitulé
Le Siège de Lyon ou le triomphe de la Calomnie. Son auteur
est Thomas Nicolas Casati50 un peintre lyonnais d’origine
italienne qui servit comme caporal dans l’armée
de Précy :
«Quant aux muscadins j’ai dit plus haut que ce sont
les commis de magasins, mais comme en ce jour là, il
paraissoit que tout devoit concourir à la défense
générale de la ville en danger, les négociants
et tout bon citoyen pris les armes pour résister à
l’oppression dont on étoit si visiblement menacés
par les patriotes établis à l’hotel comun.
Ce sobriquet a été ensuite conservé à
ce parti par les soins de la Convention qui a trouvé
dans cette épithète, un moyen de plus pour les
rendre ridicules[…]»51
Si
les soldats lyonnais de l’armée du siège
se sont retrouvés affublés du même sobriquet
que la milice réactionnaire d’Imbert Colomès,
il ne faut pas en conclure que ces insurgés étaient
un ramassis de jeunes gens bien nés et de commis du négoce.
Plusieurs travaux52 ont établi que la révolte
des Lyonnais du 29 mai 1793 était le fait d’abord
de républicains, modérés mais sincères,
qui voulaient renverser la municipalité du «Chalier»
Bertrand pour des raisons purement Lyonnaises.
Leur
drame a été qu’au moment où ils s’insurgeaient
contre cette municipalité «enragée»,
le mouvement de bascule inverse s’opérait à
Paris avec la proscription des Girondins.
Les braises de cette révolution municipale furent attisées
d’abord par les royalistes qui avaient participé
à la journée du 29 mai, puis par quelques députés
girondins en fuite. La rupture avec Paris fut consommée
dès la mi-juillet avec l’exécution de Chalier.
A Lyon on créa une armée départementale
tandis que le représentants Dubois Crancé commençait
à mobiliser le département de l’Isère
et à écrire au comité de salut public pour
détourner une partie de l’armée des Alpes
afin de mater Lyon.
Le siège de
Lyon en 1793
(Gravure allemande - Musée
Historique de Lyon)
|
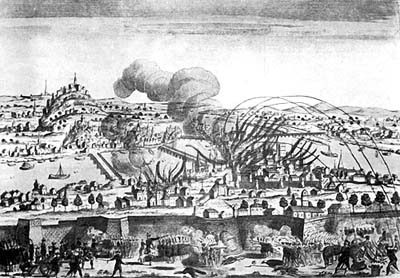 |
Dès
lors, les royalistes qui formaient l’essentiel de l’État-major
de l’armée départementale prirent de plus
en plus d’influence. Influence qui allait bien entendu
s’accroître encore lorsque les armées de la
Convention mirent le siège devant Lyon, le 7 août.
Pendant un temps, les Lyonnais pourront se croire les plus forts
et ils réussiront même à occuper Saint-Étienne
et surtout Montbrison avec le soutien des royalistes locaux.
Mais les représentants en mission dépêchés
pour conduire les opérations finirent par rassembler
plus de cinquante mille hommes sous les murs de la ville et
surtout à la cerner complètement. Dès lors
l’investissement ne pouvait être que retardé
et ce n’est certainement pas la stratégie purement
défensive du commandant en chef des troupes lyonnaises,
le général Précy, qui aurait pu l’empêcher.
Après
un baroud d’honneur victorieux, mais terriblement meurtrier,
le 29 septembre, les Lyonnais surent qu’ils avaient perdu.
Les autorités civiles, malgré l’opposition
du commandement militaire, tentèrent de négocier
une réddition honorable. Précy, quant à
lui fit savoir à ses fidèles qu’il allait
tenter une sortie. Celle-ci s’opèra le 9 octobre
au matin.
Des officiers royalistes, Lyonnais ou non, certains revenus
d’émigration pour se jeter dans la ville rebelle,
des nobles du Forez ayant gagné la capitale des Gaules
dans les rangs des Lyonnais venus occuper Montbrison, des administrateurs
insurgés inquiets pour leurs têtes, quelques femmes…
Mais aussi des hommes de la troupe, ceux des unités sûres
à qui l’on a fait passer la consigne, et sans doute
encore, ceux qui ont suivi le mouvement ou qui ont réussi
à savoir.
Dans des proportions qui restent à déterminer,
voilà les hommes qui composent cette troupe. La
plupart partent pour ne plus revenir ; et comme ils en sont
conscients, dans la mesure du possible ils emportent tous leurs
biens.
Ce sont les muscadins. Nous les retrouverons bientôt dans
les parages de Theizé.